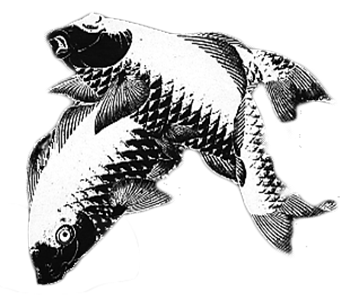Pour l’amour du AI….
Forger un amour moderne
Petite histoire de la traduction de l’amour en langue japonaise : ren.ai
Jean-Michel Butel (INALCO, CEJ) Petite histoire de la traduction de l’amour en langue japonaise: Ai È, in Catherine Mayaux (sous la direction de), France-Japon : regards croisés. Echanges littéraires et mutations culturelles, Littératures de langue française, vol. 7, Peter Lang, Berne, 2007, p. 107-119.

Dans le Japon du dernier tiers du XIXe siècle, l’examen de l’Occident crée un sentiment d’urgence. Il faut sans tarder se doter de nouveaux outils, technologiques comme conceptuels. La société japonaise se doit d’appartenir aux nations développées, les mots clefs sont progrès, évolution, amélioration (kairyo), de la production, de la race, des structures sociales, des individus. La société nouvelle se sent l’obligation d’instaurer une forme familiale moderne. La redéfinition de la famille et des rapports en son sein appelle l’amélioration de la relation homme-femme, l’établissement d’une nouvelle égalité. Elle crée aussi la conviction d’une nécessité: il faut forger un nouveau mot, digne de cette nouvelle époque, pour décrire au mieux une relation moderne entre les sexes.
Cette conviction est d’abord celle des penseurs et des moralistes, dès le début de l’ère Meiji, souvent sous l’influence des écrits chrétiens. Elle anime également les écrivains militant pour de nouvelles formes littéraires. Tsubo uchi Shôyô par exemple qui, dans son explication fondatrice de L’essence du roman (1885), donne à la littérature un nouveau but, la description des sentiments humains (ninjô), de ce qu’il y a au fond du cœur de l’homme, à commencer par le sentiment amoureux.
Mais comment parler d’amour ? Avec quels mots ? Shôyô, comme ses contemporains, hésite. Le vocabulaire japonais est extrêmement riche, et une grande partie de la littérature d’Edo s’est déjà intéressée, à travers la mise en scène des courtisanes et des quartiers réservés notamment, au tourment amoureux. Pourtant rien ne semble correspondre à l’objet de la nouvelle mission qu’il fixe à l’écrivain. Il décide donc, dans un premier temps, de conserver le terme anglais love (qu’il transcrit en katakana, avec quelques hésitations, rabu, râbu, ou rabbu), quitte à l’expliquer à ses lecteurs. Kimi o rabu [ai] shite iru … Quand, dans l’un des premiers romans de Meiji, Shôyô tente ce qui est sans doute le premier « I love you” de la littérature japonaise, c’est bien le mot anglais love (rabu) qui est mis en avant, le caractère chinois lu ai, indiqué entre crochets, n’ayant que fonction de note explicative. On pourrait croire à un snobisme de jeune écrivain. Le sentiment de ne pouvoir utiliser les mots anciens pour décrire un amour plus « évolué » semble pourtant bien réel. Car il s’agit bien de parvenir à un nouveau stade de l’évolution pour un grand nombre d’écrivains et de penseurs de l’époque, et à leur suite, très constamment, dans la littérature, les ouvrages de morale ou les traités de sexologie, au moins jusque dans les années 1930.

Comme le dit Michiko Suzuki, en analysant les processus de construction de la femme japonaise moderne, “since the mid-nineteenth century, love had been viewed as a Western ideal with which to measure individual and national advancements”. La revue Jogaku zasshi trace par exemple une histoire des progrès (shinpô) de l’amour associant à chaque étape de l’évolution sociale un certain type de relation homme-femme : le désir charnel (iro) au stade barbare (yaban) de la société, la passion (chi) au stade semi-developpé (hankai), et l’amour (ai) à la civilisation (kaika). Or l’idée d’une élaboration de plus en plus raffinée de l’amour grâce , en particulier, au christianisme n’est pas propre à une mentalité de jeunes colonisés, contrairement à ce qu’en disent certains auteurs japonais. On la rencontre chez les meilleurs auteurs occidentaux comme chez des historiens plus douteux. Nous sommes bien là en présence d’un paradigme moderne, que les auteurs de Meiji tentèrent d’adopter, un paradigme que nous ne partageons plus qu’à moitié, la tendance actuelle étant plutôt de chercher à comprendre les pratiques amoureuses les plus contemporaines en considérant ce qui est déterminé par le physio logique ou relevant du comportement animal.
Dans le texte de Shôyô que nous évoquions, ai n’est pas encore une traduction systématique de love, mais bien une précision du sens du mot anglais. Celui-ci peut d’ailleurs être expliqué par d’autres mots dans d’autres passages : lorsque, dans le même roman, Shôyô décrit les trois niveaux de l’amour, c’est en utilisant iro comme terme générique (irogoto : les choses de l’amour), puis koi pour ses manifestations concrètes.
On perçoit toutefois une tendance progressive dans les vingt premières années de Meiji à considérer qu’ai est sans doute la moins pire des équivalences. Cela n’allait pas de soi. Sans trop entrer dans les détails des sens de ce mot au Japon, rappelons que le terme connaît au moins trois sens.

La première apparition du caractère chinois lu, ai au Japon, remonte au moins au Man’yôshû, poème 802 (rédigé entre 660 et 733). Ai est d’abord un concept importé au Japon en même temps que l’écriture et le bouddhisme, et à ce titre fortement connoté par la vision négative qu’a le bouddhisme de l’attachement, dont il est en effet l’une des douze motivations, probablement la plus forte (sens 1a). Dans le même temps il semble pouvoir désigner dans ce cadre un mouvement du cœur positif qui serait assez proche de l’empathie pour le monde (sens 1b).
Ai a ensuite connu des développements propres à la situation japonaise et a pu désigner, dans un sens restreint, l’attitude d’un supérieur pour un inférieur (l’attention portée par l’homme à la femme ; sens 2.
Ai, enfin, est un mot qui apparaît à la fin de l’époque d’Edo, dans les dictionnaires élaborés en Chine par les missionnaires protestants anglo-saxons, pour rendre l’anglais love. Son usage se développe par focalisation sur son sens 1b.
Le phénomène est récurrent: les premiers traducteurs japonais de la prose occidentale à Meiji se servent de ces dictionnaires de langue chinoise, ou anglais-chinois, et reprennent bien souvent les correspondances qui y sont proposées. Ce faisant, ils réduisent le mot à l’un des sens qu’il connaissait au Japon, ce qui fonctionne un temps, mais crée vite un sentiment d’étrangeté. C’est le cas pour ai qui est constitué comme équivalent de love, aux dépens d’autres mots pourtant évoqués dans un premier temps, comme iro, koi, ou nasake, ainsi que des multiples composés formés des caractères qui servent à les transcrire. Dans ce processus, le terme occidental constitue le paramètre selon lequel des mots proches vont être redéfinis. Ainsi, s’il ne fait pas de doute que les quatre termes dont nous rappelions la concurrence possédaient des champs sémantiques distincts avant Meiji, il est très difficile aujourd’hui d’avoir une claire vision de leurs différences.
Love a en effet brouillé la carte en traçant de nouvelles frontières : dans le même temps qu’ai se rapprochait de l’amour universel et devenait incapable d’évoquer un amour charnel, iro et koi ont été repoussés vers l’aspect érotique de l’amour. Plus précisément, iro s’est vu associer de façon irrémédiable à l’amour sensuel dont on fait l’expérience dans le monde de la prostitution, à la luxure (lust), alors que koi a été un temps délaissé, son incapacité à établir une distinction entre le charnel et le spirituel semblant soudain défaut rédhibitoire. Il a fallu toute l’influence des pasteurs sur l’éducation de l’élite intellectuelle de Meiji pour que ce que l’on appellera plus tard une imposture devienne la norme.

Ai est ainsi constitué comme un concept élevé, exprimant un amour général détaché de la concupiscence : amour de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu, amour d’un principe, amour des hommes entre eux, dont celui l’homme et de la femme. On se rend mal compte combien penser ces différentes relations avec un même mot, avec un mot qui de plus nie toute asymétrie, toute hiérarchie dans la relation, est en soi une révolution. Si habitués sans doute à ce discours chrétien tellement rabâché qu’il en est devenu fade, nous oublions que dire la relation de Dieu à l’homme et de l’homme à Dieu avec un mot identique peut déjà sembler une hérésie. Nous ne percevons plus ce qu’a d’étonnant le premier commandement donné par le Christ avec un vocabulaire qui ne pose pas de distinction entre la divinité et le commun des mortels, ni entre soi et l’autre : Thou shalt love thy Lord thy God… Thou shalt love thy neigbourgh as thyself… Or c’est là le cœur du débat pour les intellectuels chrétiens de cette première moitié de Meiji : trouver un mot pour dire la plus parfaite des égalités et la poser comme principe universel.
En attendant, si ai est encore la moins imparfaite des équivalences, il reste trop général quand on veut évoquer les formes spécifiques que prend l’amour dans une relation sociale singulière. On formera donc des mots composés où un caractère chinois vient compléter et préciser le sens général d’ai. Les dictionnaires recensent au moins 18 composés de type [ai+ 1 caractère], et 36 composés inverses [1 caractère + ai]. Le nombre est impressionnant ! Il n’est pourtant qu’un reflet de la facilité avec laquelle les écrivains de Meiji créaient des néologismes, d’ailleurs parfois trop éphémères pour avoir été recensés. C’est dire l’étendue de la palette qui était la leur. Pour caractériser donc cet amour de type universel qui se réalise au sein d’un couple hétérosexuel, ils forgent, après bien des tentatives, le terme ren.ai, qui associe l’ai moderne au koi pré-méjien. Le mot en vient à désigner un très fort attachement, la passion amoureuse. Le même signe chinois est en effet lu koi quand il est utilisé seul, et ren, le plus souvent, quand il est associé à un autre caractère.
Le premier exemple d’utilisation du composé ren.ai dans un document japonais date de 1870-71 et est dû à un traducteur autochtone, Nakamura Masanao (1832-1891). Dans sonSaigoku risshi hen, traduction du Self Help (1859) de Samuel Smiles, Nakamura tente de rendre la phrase “to have fallen deeply in love with a young lady of the village” par: muranaka no shojo o mite fukaku ren.ai shi. Pourquoi donc Nakamura a-t-il choisi ren.ai plutôt qu’un des nombreux autres mots en concurrence dans le vocabulaire japonais ? Parce qu’il a été, comme de nombreux traducteurs et intellectuels japonais de l’époque, fortement influencé dans ses choix par l’ Eika jiten (1847 -48), dictionnaire anglais-chinois (moderne) du pasteur Walter Henry Medhurst (1796 -1857). Celui-ci proposait, pour la première fois dans un dictionnaire, l’adéquation du verbe to love et de ren’ai. Celle-ci restait toutefois une tentative théorique : le dictionnaire ne fournissait pas encore d’exemples d’utilisation.
Nakamura fait figure de pionnier, mais pas de fondateur. Le terme ren.ai n’apparaît d’ailleurs qu’une fois dans tout le livre, dont le thème central est loin de se constituer autour des affres de l’amour. La première apparition de ren.ai dans un ouvrage de référence publié au Japon est plus tardive. Elle se note dans un dictionnaire de français, le Dictionnaire universel Français-Japonais (Futsuwa jirin), publié en 1887 sous la direction de Nomura Taiky. Le nom “Amour” y appelle ren’ai, shôai, kôai . Ren.ai entre alors peu à peu en service. Pour qu’il devienne réellement un mot d’usage courant, il faut cependant encore patienter afin que se combinent deux facteurs : que l’on se mette à traduire et à produire des romans d’amour ; que le christianisme s’établissent chez les intellectuels japonais. L’un de ses meilleurs promoteurs est Iwamoto Yoshiharu dont la revue, qui articule justement moralisme chrétien et promotion de la littérature, rassemblera quelques textes d’anthologie sur cette définition l’amour moderne.

C’est dans cette revue qu’est fixée la traduction de love que nous connaissons actuellement. Dans une critique qu’il y publie en octobre 1890, Iwamoto félicite le traducteur de Dora Thorne d’avoir su associer les deux caractères lus koi et ai pour traduire love dans un composé « pur et juste » (kiyoku tadashiku):
Le traducteur a traduit le sentiment amoureux (rabu (ren.ai) no jô») de la manière la plus pure et la plus juste, il a eu l’habileté d’utiliser avec grande élégance des caractères d’écriture dont l’utilisation japonaise commune abonde en associations impures. »
En attachant le terme le plus commun des chansons et romans d’amour préoccidentaux, koi, au caractère chinois désignant un amour asexué, ai, le composé semble à même de retranscrire la tentative que le moraliste découvre dans les histoires d’amour occidentales pour comprendre l’amour en distinguant amour charnel et amour “du plus profond de son âme” “Or les hommes japonais ( … ) n’aiment pas les femmes de toute leur âme”. Le nouveau mot doit permettre d’éduquer à un nouveau type de relation.
Un mois plus tard, en novembre 1890, paraît, toujours dans la même revue, “Philosophie de l’amour”, article dithyrambique d’un certain Aizan Sei qui finit sur cette belle envolée :
Ah, amour (ren.ai) qui révolutionnes l’âme et le corps de l’homme ! Amour qui défriches de nouveaux territoires du goût et de l’imagination ! Amour qui fais les héros et les braves ! Amour qui établis les maisons et solidifies la nation ! J’aimerais, émergeant parmi les poètes, faire en sorte que les nombreux écrivains qui se sont fourvoyés en écrivant sur toi écarquillent les yeux de surprise…
L’amour est alors une force mystérieuse à laquelle on attribue le pouvoir à la fois de faire accéder l’individu à un état supérieur d’humanité (héros, brave), et de construire une nouvelle société, une nation moderne basée sur des familles solides. Aizan exprime clairement l’évolution qui en jeu et l’objectif de ces années de Meiji qui lie si étroitement réussites individuelle et nationale via l’établissement de familles clairement définies.

Le texte qui semble avoir été le plus déterminant dans cette construction d’une idéologie de l’amour est publié par un proche d’Aizan, Kitamura Tôkoku . Celui -ci rédige , toujours dans la revue d’Iwamoto, des passages qui resteront célèbres dans l’histoire de la littérature. L’évolution de sa pensée, la place grandissante qu’il accordera à l’amour, vont de pair avec l’affinement de son vocabulaire. Tôkoku ne va pas tout de suite adopter le mot ren.ai. En janvier 1890, quand il rédige “De la littérature actuelle comme marée”, il retient tout d’abord le composé airen (il n’y a de plus grande aspiration dans l’univers que l’amour [airen]), qui n’est pas un néologisme puisqu’il désigne, dans la littérature chinoise déjà, la tendresse entre un homme et une femme. En mars 1890, il tente bien d’employer ren.ai, mais sans vraiment approfondir son sens, plutôt comme pour essayer le mot. C’est son texte Le poète las du monde et la femme qui marque le passage d’airen à ren.ai, d’un vieil amour à une révolution. Les premières phrases de ce texte, devenues célèbres pour ce qu’elles disent de la première période du romantisme au Japon, auront, plus que la prose d’Aizan, un fort retentissement dans le monde des lettres et des arts
L’amour (ren.ai) est la clef de tous les secrets de la vie humaine. Quand il y a l’amour, il y a la vie humaine, quand il manque l’amour, l’existence humaine n’a plus ni couleur ni goût.
Notons que Tôkoku envisage lui aussi l’établissement de l’amour comme un processus évolutif passant par trois stades que caractérisent les termes nikujô (littéralement « sentiment charnel », mais dont l’équivalence est posée avec le mot anglais sensual par l’indication de lecture liminaire senshuaru), jôai (affection affekushon) puis ren’ai (love rabu).
On peut ainsi dater de la fin des années 1880 et du début des années 1890 une “mode de l’amour » qui commence avec l’utilisation jouissive, et parfois un peu lyrique, d’un mot nouveau. « La mode de l’amour fut d’abord, la mode du mot “amour” (ren.ai). Ce n’est qu’ensuite que se propagea, entre les jeunes gens que le mot soutenait et à qui il insufflait du courage, la mode du comportement amoureux. Les instigateurs de cette mode sont nombreux parmi les intellectuels et leurs disciples, et tout particulièrement parmi les chrétiens protestants et ceux qui gravitaient autour d’eux.
.
Mais en cette époque de grands chambardements, alors que tout se discute, et plutôt vivement, certains commencent à s’inquiéter et cherchent à démontrer la perversité de l’amour. Comme le dit avec rage Tokutomi Sohô, en s’appuyant curieusement sur Napoléon, après avoir reconnu, dans l’un des journaux les plus actifs de la presse de Meiji, que “les relations entre hommes et femmes, le “mariage libre (jiyû kekkon), sont de nouvelles questions importantes pour la société de Meiji” :
Mais qu’est-ce donc que cet amour (ren.ai) ! Qu’est-ce donc que cette mixité! Qu’est -ce donc que le libre choix du conjoint dans le marriage.

Avec le passage d’ai à ren.ai cependant, la question que posait l’amour occidental aux moralistes japonais change d’objet. Ce qui pose problème à Sohô n’est finalement pas cet amour universel détaché des pulsions (cela reviendra plus tard) mais plutôt que l’amour soit érigé en principe moral. Les deux camps s’affrontent d’abord sur la possibilité de construire une nation à partir d’un couple formé par un “mariage libre”, par opposition au mariage organisé par l’entourage, désormais stigmatisé sous le terme de “mariage forcé” (kyôhaku kekkon). Comment faire admettre en effet que quelque chose proche d’un sentiment dont on faisait l’expérience dans les quartiers réservés puisse devenir la seule justification de ce mariage qu’on est en passe d’établir comme l’une des institutions essentielles de la nation !
C’est pourtant le tour de passe-passe que vont réussir à réaliser les moralistes chrétiens et les écrivains de Meiji. Ce faisant, et ceci est une évolution importante en phase avec les réflexions des juristes préparant le code civil, l’amour devient avant tout conjugal. Alors que c’était, inévitablement, en suivant les décors habituels de la littérature précédente, une relation entre un homme et courtisane que Shôyô mettait en scène dans Portraits d’étudiants d’aujourd’hui, le roman suivant, Epouses et époux (Imo to se kagami, 1885 -1886) évoque cette fois différents types de couples mariés, comme si le couple conjugal devenait le seul endroit où pouvait être mis en scène l’amour. Shôyô y chante lui aussi le “mariage libre” (jiyû kekkon), c’est à dire décidé librement par les futurs époux. Son roman inaugure une sorte de « boom de l’amour conjugal (fûfu-ai no bûmu) dans la littérature de Meiji.
Le tour de force de la modernité est ainsi de parvenir à canaliser l’énergie exceptionnelle et potentiellement destructrice de l’ordre social que suscite la passion amoureuse dans une relation quotidienne conjugale. La gestion de la passion amoureuse se faisait à Edo par la construction d’un espace délimité, le quartier réservé. Elle semble idéalement devoir se faire à partir de la fin des années 1880, alors que se redéfinissent les sphères publiques et privées, dans cet espace intime qu’est le couple marié. En somme, le privé devient familial. Elle réclame également la construction d’un nouvel individu, propre à la vivre. Et c’est là que les hommes de Meiji vont se trouver confrontés à un paradoxe qui articule un grand nombre des œuvres littéraires de l’époque. Si se marier sur la base d’un choix personnel, en se fiant à un sentiment ressenti, est un idéal à suivre, comment faire ensuite, dans le quotidien du mariage ? Les nouveaux Japonais de Meiji sont-il déjà des individus suffisamment modernes pour pouvoir vivre cette relation nouvelle ? C’est une gêne, et même un doute douloureux qui anime les hommes éclairés de Meiji, Tôkoku y compris. En sommes-nous capables ? Et si nous, qui lisons des ouvrages occidentaux, le pouvons, ce qui n’est pas certain, les femmes japonaises, nos sœurs, sont-elles, elles, prêtes à construire un couple moderne ? Ne leur manque-t-il pas à la fois cette distance un peu hautaine des belles occidentales , et le désir de construire une complicité quotidienne ? La femme japonaise n’est-elle pas trop “prosaïque” finalement ? A l’enthousiasme de la découverte d’un principe universel propre à une société civilisée (ai), va donc suivre les tourments d’une passion idéalisée (ren.ai) dont l’impossibilité, en réalité consubstantielle à l’alliance du koi et du ai, est souvent rapportée à l’immaturité, ou à l’indifférence, des femmes de Meiji.

Ren.ai est certes une réussite comme mot nouveau, et son emprise sur les rêves des romanciers et des jeunes japonais n’a cessé de se faire plus forte jusqu’à emplir aujourd’hui de façon quasi étouffante les discours des médias. Son succès, qui correspond à une modification de la conscience de soi et du rapport à l’autre qu’appelle la modernité, peut sans doute également s’expliquer par son statut de “mot de traduction”. Pourtant, ren.ai est un échec, en tant que mot de traduction justement. Il n’a pu rendre du “love” occidental qu’une petite partie, la partie exotique, celle qui, dans un cadre où l’Occident était érigé en modèle, paraissait la plus nouvelle, la plus progressiste. Car il est finalement inapte à dire toute l’étendue du concept que les moralistes de Meiji tentaient d’introduire dans leur pays. Lacunaire, ren.ai a toutefois été utile : il a permis que s’élabore un “discours amoureux”, que les mots anciens n’auraient sans doute pas permis. Celui-ci sera peu à peu relayé par les femmes, souvent inspirées par leurs consœurs occidentales, qui nourriront une “idéologie moderne de l’amour” (kindai ren’ai ideorogii)dont on voit les effets tout au long du XXe siècle.
Sorry, the comment form is closed at this time.